Mon actualité

Je devais aller me coucher et je me suis dit regarde ce qu’il y a sur Arte et je tombe sur un sujet récurrent mais traité autrement et voici ce que j’en pense.
Il y a des pays réputés pour le tourisme sexuel mais il est important de comprendre les causes, les motivations des uns et des autres, les souffrances et peines.
Dans ce reportage il est question de blanches avec des formes et un certain âge. L’âge et la forme sont des critères d’exclusion dans les pays occidentaux ce qui n’est pas le cas dans le tiers monde. Avec la mondialisation, les informations circulent et chacun peut trouver une part de bonheur ailleurs que chez soi. Cette quête du bonheur ne se fait pas dans la joie, il y a beaucoup de souffrances et de mensonge. Des questions interculturelles et des naïvetés indicibles sont à explorer.
Les jeunes qui s’adonnent à ce commerce, sont souvent des mariés qui ne cachent pas à leurs épouses ce qu’ils font à la plage. Ces épouses sont souvent complices et sont représentées comme des sœurs, des cousines jusqu’au jour où la dame blanche comprend la manœuvre. Dans ce film d’ailleurs la dame blanche a surpris son soi*disant ami qu’elle n’a cessé de financer, de payer les frais médicaux de sa famille élargie. Le mensonge et la tricherie se révèlent toujours au grand jour, les européennes ne sont dupes comme certains le pensent et c’est dommage. Ce n’est pas parce que un être est en souffrance qu’on doit l’entraîner dans un leurre, dans une habitude puis, l’exploiter jusqu’à la lie et la laisser tomber sans espoir.
Je demanderai aussi aux jeunes et aux dames qui pratiquent et contribuent à ce commerce de penser aux maladies comme le sida, aux souffrances silencieuses des épouses restées loin des lieux de dépravations.
Ce jeune homme qui a été payé pour faire un streap tease à l’occasion de l’anniversaire de cette dame s’est donné en spectacle de la façon la plus vile comme une bête, un objet sexuel, vu et exploré sous toutes les coutures puis renvoyé parce que les dames n’ont pas eu et vu l’effet escompté de son dit «mamba noir-phallus»
Il faut comprendre que ces dames viennent avec leurs économies et qu’elles ne sont pas riches, le travail lié au sexe n’est pas une bonne chose pour les pays du tiers monde, c’est une mauvaise publicité qui ne nous honore pas depuis l’esclavage, « femmes noires chaudes, hommes noir étalon » que de préjugés qui ne sont pas fondés. Il a y a autant de femmes blanches chaudes que de femmes noires chaudes pareil chez les hommes et le contraires existent bien dans toutes les cultures.
La pauvreté est un poison et il faut former et donner du travail aux personnes pour faire vivre dignement les citoyens du monde. Le sexe ne doit pas être lié à l’argent, le cœur exige des sentiments et de la douceur.
Excellent film qui décille nos yeux. Pape B CISSOKO
Programmation spéciale Ulrich Seidl La trilogie « Paradis » et un documentaire inédit
PARADIS : AMOUR
Un regard sans concession sur le tourisme sexuel en Afrique à travers le portrait tragi-comique d'une femme mûre en quête d'amour... "Paradis : amour" est la première partie de la trilogie d'Ulrich Seidl, qui se poursuit avec "Paradis : foi" et "Paradis : espoir".
Pour se consoler de sa solitude, Teresa, une Autrichienne quinquagénaire, s'offre des vacances au Kenya. Sur les plages, de jeunes hommes appâtent avec des bijoux de pacotille ces Occidentales d'âge mûr et souvent bien en chair, surnommées "sugar mamas". Mais c'est pour mieux leur proposer des relations sexuelles tarifées. Dans ce paradis factice, Teresa cherche un impossible amour.
Jeu de dupes
Habitué des documentaires qui auscultent son pays, Ulrich Seidl scrute une forme de néocolonialisme fécondée par un implacable instrument de domination : le sexe. Dans Paradis : amour, première partie d'un triptyque, il filme au plus près des étreintes vides de sentiment, employant des acteurs africains non professionnels, et montre sans juger, entre grotesque et pathétique, le spectacle d'une chair désespérément triste. Un humour grinçant et des images saisissantes sauvent le film d'un nihilisme radical.
http://www.arte.tv/guide/fr/042227-000-A/paradis-amour#details-comments (116 min) ARTE
bakary gueye commentaire trouvé
j’ai ri mais j’ai souffert pour cette dame mais aussi pitié pour cette jeunesse qui joue ou travaille et ment de grands écarts pour se faire payer donner de son corps en faisant jouer sa propre famille est de l’ordre du pathétique des hommes draguent et leurs épouses sont au courant de la source d’argent finalement leurs hommes sont des objets à louer j’ai beaucoup souffert en voyant ce film j’ai beaucoup respecté ces dames qui voulaient être heureuse et se sentir bien dans leur peau le garçon démasqué a reçu des coups et cela traduit bien que les blanches ne sont bêtes
le trip tasse m a choqué je donne 10 a ce cinéaste qui montre le malheur de l’existence la misère du monde et des sentiments
le 27 février 2016 je serai à Champigny auprès du Doyen Djiby SY pour parler des valeurs dans le travail
Nos jeunes doivent comprendre que chaque métier est important et c'est notre façon de nous accrocher à notre travail qui lui donnera du sens
Ingénieur et balayeur sont tous des acteurs de la société.
Le samedi 30 avril 2016
Je serai à Compiègne pour parler des Albinos.
On ne parle pas assez de la souffrance et de la marginalisation des parents, de leurs inquiétudes, etc
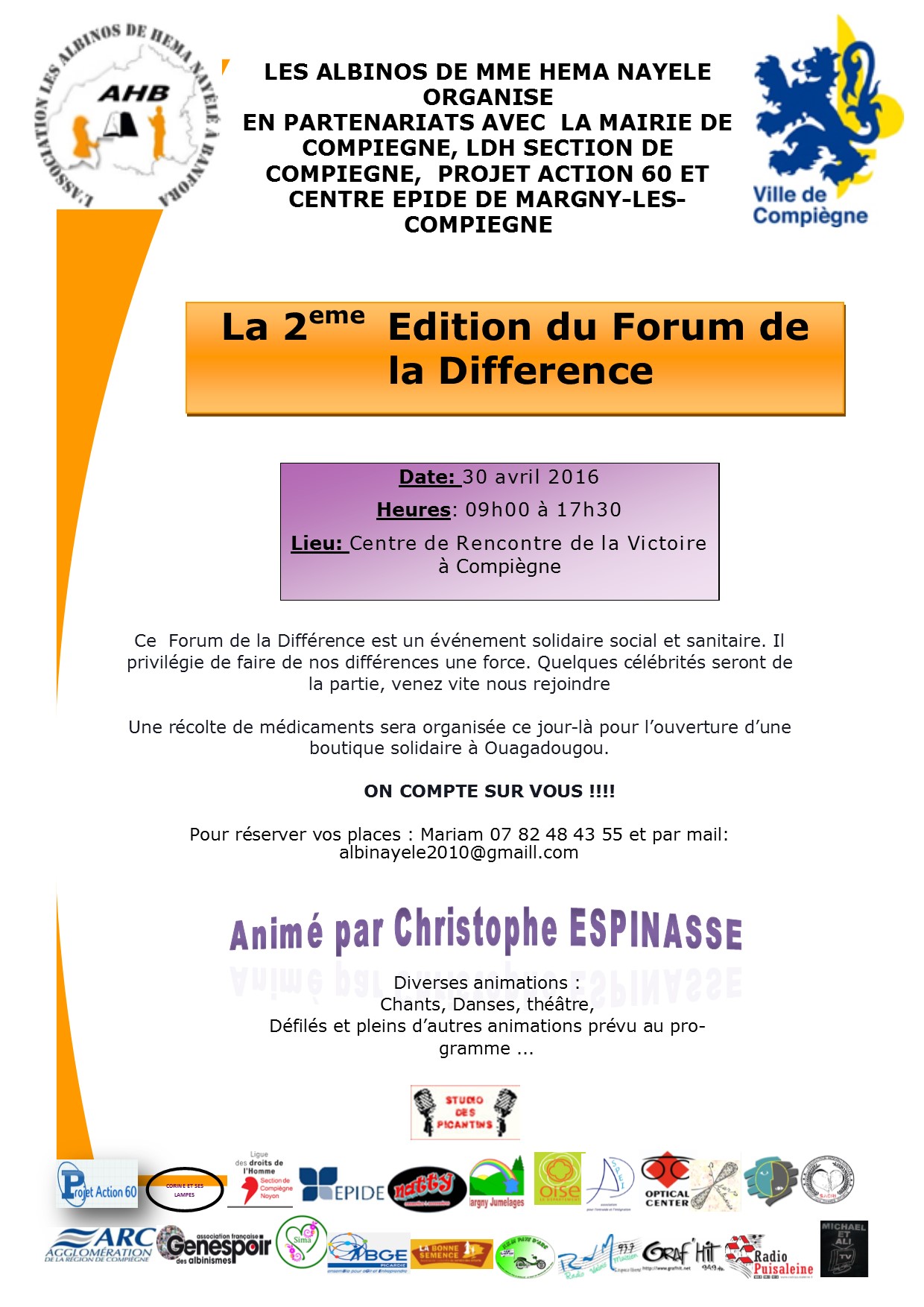
En octobre 16/10/2015 j'animerai une conférence débat pour l'association Rayon de soleil à chennevière dans le Val de Marne /France
-Comment aider nos enfants à réussir leur scolarité ?
Puis 13 Novembre 2015 je parlerai des couples mixtes, des mariages mixtes , des familles recomposées
Tout ceci entre dans le cadre de l'accompagnement à la Parentalité
MGF : Excision- la région de Kolda au Sénégal affiche un taux de 85%
OCT 12, 2015 PAPE CISSOKO
« Le Sénégal a pénalisé la pratique de l'excision mais la réalité est toute autre. On ne doit pas porter atteinte au corps de ces jeunes filles, la tradition à ses vérités et la modernité parce qu'elle comprend mieux les choses doit imposer ou changer les mentalités. De grâce posez vos lames, couteaux etc, vous faites mal à nos sœurs. On peut transmettre nos valeurs sans couper le corps, le clitoris est un organe important il faut la préserver. Doit-on toujours au nom de la coutume continuer des pratiques qui ne se justifient plus ». Pape CISSOKO ichrono
:
Vélingara, 10 oct (APS) – La pratique de l'excision est très élevée dans la région de Kolda avec un taux de 85 %, a relevé, samedi, Marie Tall Diop, chargée de projet à Enda Santé à Kolda.
''Nous sommes au regret de constater que le taux de la pratique de l'excision est très élevé dans la région de Kolda, avec 85%, mais aussi des régions de Sédhiou, 86% et Ziguinchor 56%'', a déploré Marie Tall Diop.
Dans ces régions, notamment dans les zones rurales de la région de Kolda, ''il y a beaucoup filles victimes de viol'', a dit Mme Diop au cours d'un atelier de plaidoyer pour l'abandon des violences sexuelles.
Pour inverser la tendance dans le département de Vélingara, Enda Santé qui a un réseau de relais Educateurs-paires dans les communes de Diaobé-Kabendou et Vélingara a initié un atelier à l'intention des leaders communautaires, religieux, les forces de l'ordre, les directeurs d'écoles et les autorités administratives.
''Les leaders communautaires et autres que nous avons invité à cet atelier ont une place centrale dans le dispositif de recherche de solutions car malgré le silence qui entoure les violences sexuelles et mutilations génitales féminines, c'est à eux que les victimes s'adressent pour partager leur souffrance'', a expliqué Marie Tall Diop.
La chargée de projet de Enda Santé a estimé qu'à l'issue de cet atelier, il sera possible de prévenir et améliorer la prise en charge des cas de violences sexuelles et de la pratique de l'excision par l'implication et l'engagement des leaders communautaires, des forces de l'ordre, des religieux etc.
Dans les communes de Diaobé-Kabendou et Vélingara, il a été recensé par les éducateurs-paires de Enda Santé au total pour le trimestre juillet-Août-Septembre 17 cas de viols dont des filles âgées 8 ans et 12 ans.
MSM/OID
les castes au Senegal
http://www.ichrono.info/index.php/blog/item/1600-survivance-nos-societes-doivent-se-debarrasser-des-castes-le-senegal-et-l-afrique-y-gagneraient
Romans et pièces de théatres
Transmissions Il est bon de transmettre aux jeunes générations le meilleur dans notre héritage culturel pour les préparer à l'altérité
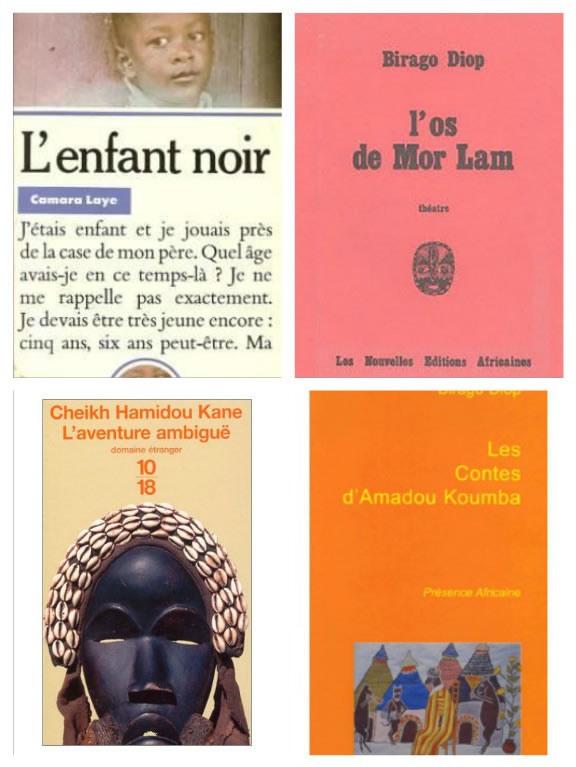
L'Aventure ambiguë Roman de Cheikh Hamidou Kane
L'Aventure ambiguë est un roman de Cheikh Hamidou Kane publié en 1961. Il reçoit le Grand prix littéraire d'Afrique noire en 1962.
De manière significative "L'aventure ambiguë", histoire d'un itinéraire spirituel, porte en sous-titre "récit". Ce qui frappe en effet le lecteur de ce livre, c'est le classicisme dû autant à la retenue du ton qu'à la portée universelle de la réflexion philosophique. Sans doute l'auteur oppose-t-il à la pensée technique de l'Occident, essentiellement tournée vers l'action, la pensée de l'Islam, repliée sur elle-même, mais au-delà de cette confrontation c'est finalement le problème de l'existence qui est posé. On voit par là comment Cheikh Hamidou Kane, échappant à la donnée temporelle et politique de son sujet, l'angoisse d'être noir, débouche sur une réflexion qui nous concerne tous : l'angoisse d'être homme.>>
J. Chevrier Le Monde>>>
AVENTURE AMBIGUË (l'). Roman de Cheikh Hamidou Kane (Sénégal, né en 1928), publié à Paris chez Julliard en 1961.
Synopsis
Première partie. Samba Diallo est un enfant qui a été confié par son père, Le Chevalier, au chef de la tribu des Diallobé afin qu'il suive l'enseignement d'un sévère maître d'école coranique, Thierno. Ce dernier a très vite repéré chez l'enfant des qualités exceptionnelles. Alors qu'il est arrivé à l'âge de se rendre à l'école européenne, les avis sont partagés: le chef des Diallobé hésite à l'y envoyer, le maître d'école le déconseille vivement et la Grande Royale, sœur du chef, y est au contraire favorable. Suivant les recommandations de la Grande Royale (afin qu'il apprenne à "vaincre sans avoir raison"), Samba Diallo fréquente l'école européenne, s'y montre excellent élève, apprend très vite et se voit proposer de poursuivre ses études à Paris.
Seconde partie. À Paris, Samba Diallo vit très mal son isolement et son déchirement entre ses deux cultures. Il rencontre Lucienne, une communiste, et Pierre-Louis, un avocat antillais militant, avec lesquels il débat de la confrontation et du bien-fondé de l'interpénétration des cultures. À la demande de son père, il regagne l'Afrique. Il rencontre un homme, devenu fou après un séjour en Europe, qui lui propose de prendre la succession du maître Thierno, décédé. Mais Samba Diallo a abandonné la pratique religieuse. Le fou poignarde Samba et met ainsi fin à l'ambiguïté de son aventure.
« Je ne suis un écrivain qu’à titre accessoire », aime à rappeler le Sénégalais Cheikh Hamidou Kane, auteur de deux romans. Agronome et homme politique de premier plan dans son pays, l’homme a consacré peu de temps à l’écriture. Grâce au succès phénoménal de son premier roman, il s’est rapidement imposé comme une des figures incontournables des Lettres africaines.
L’Aventure ambiguë, qui raconte le drame du métissage et de la double culture, est un récit emblématique de l’expérience coloniale en Afrique. Il a marqué l’esprit de générations d’Africains qui se reconnaissent dans le parcours de son héros, Samba Diallo - des berges de la Vallée du fleuve Sénégal aux bancs de l’école française. Les cinquante ans de sa parution ont été célébrés au siège de l’Organisation internationale de la Francophonie à Paris. Dans l’interview qu’il nous a accordée, Kane parle de la portée universelle de son roman, des heurs et malheurs de l’intellectuel colonisé, de la responsabilité des élites dans la faillite du développement africain, de la « dépossession » identitaire… Et des Gardiens du temple, son deuxième livre, paru en 1995, qui poursuit la quête de ses personnages mais dans des circonstances postcoloniales.
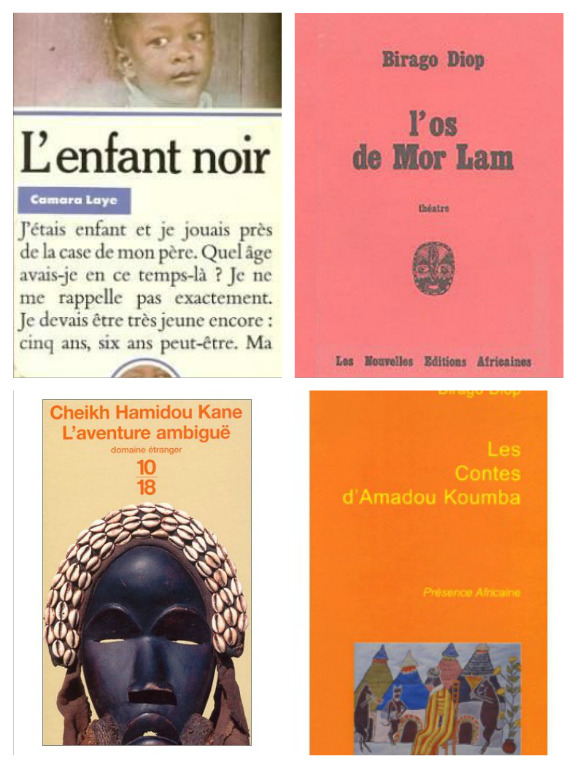
L'Enfant noir Roman de Camara Laye
L'enfant noir grandit dans un village de Haute-Guinée où le merveilleux côtoie quotidiennement la réalité. Son père, forgeron, travaille l'or au rythme de la harpe des griots et des incantations aux génies du feu et du vent. Respectée de tous, sa mère jouit de mystérieux pouvoirs sur les êtres et les choses. Elle sait détourner les sortilèges et tenir à l'écart les crocodiles du fleuve Niger. Aîné de la famille, le petit garçon est destiné à prendre la relève de son père à l'atelier et, surtout, à perpétuer l'esprit de sa caste au sein du village. Mais son puissant désir d'apprendre l'entraînera inéluctablement vers d'autres horizons, loin des traditions et des coutumes de son peuple...Un livre intemporel qui s'est imposé comme un classique de notre temps
L'Enfant noir de Camara Laye
Un dossier pédagogique préparé par
Christine Renaudin & Suzanne Toczyski
Sonoma State University
Résumé de L'Enfant noir de Camara Laye
organisé par chapitre
CHAPITRE 1
L'enfant qui fait l'objet du titre de l'ouvrage nous y est présenté pour la première fois sous le signe du serpent, l'animal totem de son père et du clan des forgerons.
Outre la description des lieux de son enfance-la concession, l'atelier du père, la case de la mère, celle du père et de la véranda attenante où il aime à jouer-, le chapitre évoque la lente initiation de l'enfant aux significations du serpent, animal dangereux sauf à en adopter, comme son père, le bon spécimen.
Le petit serpent noir que caresse son père à la fin du chapitre est l'animal totem du clan des forgerons, dont l'enfant se demande s'il héritera, ou s'il lui préférera le chemin de l'école.
CHAPITRE 2
Une femme ayant besoin d'un nouveau bijou pour une fête religieuse arrive chez le père du narrateur, qui est orfèvre, avec un griot qui est censé inspirer l'artisan. Suivant les exigences rituelles, le père s'est purifié le matin même, prévenu par son génie de la tâche qu'il aurait à accomplir ce jour-là. L'enfant apprécie la transformation quasi magique de l'or en bijou et l'extraordinaire travail de son père, qui est aidé dans sa tâche par la présence du petit serpent noir. La femme à qui le bijou est destiné s'émerveille devant le spectacle elle aussi, mais la mère du narrateur ne partage pas l'admiration de celle-ci, croyant au contraire que le travail de l'or ne peut que nuire à la santé de son mari.
CHAPITRE 3
La visite à la concession son oncle Lansana représente un moment privilégié pour l'enfant, qui fait le voyage de Kouroussa à Tindican accompagné du frère cadet de celui-ci. Ce voyage se caractérise par des dialogues enjoués qui aident l'enfant à supporter la difficulté de marcher si longtemps et finit par l'accueil de l'enfant par sa grand-mère.
L'enfant passe son séjour à Tindican à bien manger, à jouer avec les autres enfants, et à aider ceux-ci à chasser les oiseaux et les autres bêtes des champs cultivés. Le narrateur se distingue des autres enfants par ses habits d'écolier. La journée se termine par un repas de famille où Lansana, enfin rentré des champs, se montre bienveillant vis-à vis du petit.
CHAPITRE 4
La moisson du riz du mois de décembre est un effort communautaire puisque toutes les familles font la récolte générale le même jour. Les hommes sont responsables de la moisson proprement dite; les femmes, de leur côté, sont responsables de nourrir les travailleurs et les enfants. La moisson est présentée comme un événement joyeux auquel la communauté participe avec allégresse, chantant et travaillant au rythme du tam-tam.
Quant au narrateur, il participe à la moisson en aidant son jeune oncle. Son travail consiste à prendre les bottes d'épis récoltées par son oncle, les débarrasser de leurs tiges, les égaliser, et porter les gerbes au milieu du champ. Le narrateur reconnaît la dureté du travail et voudrait bien manier à son tour la faucille, mais son oncle l'avertit que ce travail de faucheur ne sera sans doute jamais le sien.
CHAPITRE 5
On apprend que, revenu à Kouroussa, le narrateur demeure chez sa mère, à la différence de ses frères et sœurs, qui dorment chez leur grand-mère paternelle. C'est dans ce chapitre que le narrateur nous fait le portrait de sa mère, une femme généreuse qui est chargée de la préparation de la nourriture, de l'éducation des enfants. Elle traite les apprentis de son mari comme ses propres enfants, les nourrissant et s'occupant de tous leurs besoins.
Cette femme se distingue non seulement par sa naissance noble et son air d'autorité, mais surtout par ses pouvoirs spéciaux qui lui viennent de sa position de puînée de jumeaux et du totem familial, le crocodile. Elle a une influence remarquable sur les animaux et peut puiser dans l'eau du Niger sans craindre l'attaque des crocodiles. Le narrateur apprécie les prodiges effectués par sa mère tout en reconnaissant, de son point de vue adulte, leur nature fabuleuse.
CHAPITRE 6
Le narrateur fréquente l'école coranique et, plus tard, l'école française. Dans l'une comme dans l'autre, les rapports entre filles et garçons se caractérisent par la moquerie universelle. Cependant le narrateur développe un rapport différent avec Fanta, l'amie de sa sœur.
C'est le maître d'école qui représente l'autorité, faisant régner le silence et ayant recours aux punitions corporelles. Les enfants, pour leur part, sont calmes et attentifs. Les grands sont souvent les bourreaux des petits, les forçant à faire les corvées imposées par le maître. Lorsque leurs interventions deviennent trop brutales, les parents interviennent, contraignant enfin le directeur de changer de poste.
CHAPITRE 7
Le rite de Kondèn Diara constitue la première épreuve de l'initiation des jeunes incirconcis au monde adulte. Le soir de la veille du Ramadan, les enfants à initier sont cueillis par une troupe hurlante, et participent tous à une fête communautaire, après laquelle ils subissent tous la cérémonie des lions dans un lieu sacré de la brousse. Le narrateur confie au lecteur la peur éprouvée lors de cette nuit, peur de l'inconnu, mais aussi des rugissements de lions invisibles aux enfants. A l'aube, l'instruction finie, les enfants découvrent de longs fils blancs couronnant toutes les cases de la concession et se rejoignant au somment d'un énorme fromager. Le mystère de l'installation de ces fils aussi bien que la source du rugissement des lions sont révélés par le narrateur, éloigné de son pays natal et peu soucieux des secrets de sa communauté natale.
CHAPITRE 8
Préparés par le rite de Kondèn Diara, les garçons de douze, treize et quatorze ans subissent ensuite la cérémonie de la circoncision, épreuve caractérisée par la douleur aussi bien que par la peur. Après une semaine de préparations festives pendant lesquelles les garçons, habillés de boubous cousus et de bonnets à pompon, reçoivent des cadeaux et dansent à maintes reprises le coba, danse reservée aux futurs circoncis, ceux-ci sont conduits sur une aire circulaire où l'opérateur accomplit sa tâche avec rapidité. S'ensuit une quarantaine de quatre semaines pendant lesquelles les jeunes gens sont soignés par un guérisseur et la vue des femmes leur est interdite. Le narrateur reconnaît l'importance de la séparation rituelle entre mère et fils et finit par habiter sa propre case en face de celle de la case maternelle.
CHAPITRE 9
Ce chapitre commence par le récit des adieux à Kouroussa: le narrateur décrit ses adieux à sa mère, à son père, à ses frères et ses sœurs. Le départ du jeune homme est marqué par le déchirement et la tristesse du narrateur, qui est accompagné à la gare par ses frères et sœurs, Fanta, et des griots.
La deuxième moitié du chapitre commence par le voyage du narrateur, avec une description détaillée des sentiments du narrateur lors de ce voyage. Pendant ce voyage, il passe par Dabola, Mamou et Kindia. Etant arrivé à Conakry, capitale de la Guinée, le narrateur réside avec son oncle et ses deux femmes. Il raconte les premiers jours d'école aussi bien que sa conversation avec son oncle sur les vertus des différentes écoles et carrières. Malgré ses hésitations, le narrateur reste au Collège Georges Poiret. Le chapitre se termine par le bilan de sa première année à Conakry.
CHAPITRE 10
Lors de sa deuxième année de collège, le narrateur voit régulièrement son nom au tableau d'honneur. C'est pendant cette période qu'il rencontre Marie, qui passe ses dimanches chez l'oncle du narrateur. Selon lui, ils partagent une sorte d'amitié profonde, mais le lecteur sent bien que leurs émotions sont plus fortes que celles d'une simple amitié. Les tantes du narrateur taquinent les deux jeunes gens, parlant de leurs futures fiançailles. Les deux passent beaucoup de temps ensemble, à dansant, écouter de la musique, se promener à bicyclette, etc. A la maison, le narrateur attend qu'on le serve, tandis que Marie aide au ménage.
CHAPITRE 11
Durant ses années de collège, le narrateur retourne régulièrement à Kouroussa pendant les vacances scolaires. A chaque retour il peut apprécier les efforts de sa mère pour rendre sa case plus «européenne» et correspondre à son éducation. Lors de ces visites, le narrateur reçoit ses amis et même de jeunes femmes séduisantes dont sa mère désapprouve la fréquentation. En fait le narrateur se plaint de la «tyrannie» de sa mère qui surveille tous ses mouvements, même lorsqu'il dort.
Le chapitre est surtout le récit de la grande amitié du narrateur avec Kouyaté et Check, ses camarades d'enfance. A la fin de sa deuxième année le narrateur rentre à Kouroussa et découvre que Check est très malade. La mère de celui-ci consulte les guérisseurs, qui recommandent des massages et des tisanes; Kouyaté insiste plutôt que Check aille voir un médecin au dispensaire. Malgré tous les efforts de sa mère et de ses amis, Check meurt en présence de Kouyaté et du narrateur. Celui-ci connaît ainsi son premier grand deuil.
CHAPITRE 12
Ayant reçu son certificat d'aptitude professionnelle, le narrateur a l'occasion d'aller étudier en France avec l'aide d'une bourse scolaire. La mère du narrateur refuse absolument de considérer cette idée; son père y est plus ouvert et encourage son fils à partir pour son propre bien et pour qu'il puisse revenir aider son peuple. La mère finit par comprendre qu'elle ne peut pas empêcher le départ de son fils, mais sa tristesse est profonde.
Un jour, donc, le narrateur se retrouve dans un avion qui part pour Dakar, où il laissera Marie qui va y poursuivre ses propres études. De Dakar il prendra un autre avion pour aller à Orly, d'Orly il ira à la gare Saint-Lazare en métro, et finalement à Argenteuil. Le narrateur promet de revenir, mais son dernier geste est de palper le plan du métro de Paris qui gonfle sa poche.
Glossaires par chapitre | Glossaire général | Résumés
Plan d'étude | Ressources et illustrations | Lien au site destiné aux étudiants
Page mise à jour le 11 juillet 2003
© C. Renaudin & S. Toczyski
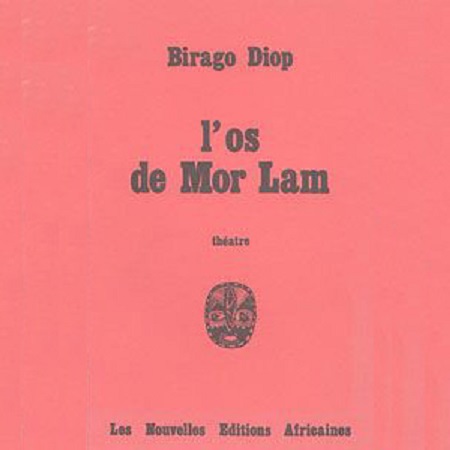
L’OS DE MOR LAM ; pièce de théâtre qui a été écrite par Birago DIOP en 1960.
Un autre classique qui a bercé nos études. Offrons, transmettons le meilleur capital culturel à nos enfants. P B CISSOKO
Il était une fois, un homme appelé Mor Lame. Il avait un confrère, « plus que frère », Moussa qu'il aimait très bien.
Un jour, Mor Lame cuisait un os de boeuf battu quand « plus que frère » lui rendit visite. Selon la tradition, il dut partager le menu avec son hôte. Or, il n'aimait prendre que de l'os, surtout l'os de la cuisse. Alors, il ne voulut pas accepter son hôte jusqu'à l'heure, où l'os sera ramolli.
Pour cela, il fit le mort, se raidit sur son lit et demanda à sa femme d'annoncer sa mort à la population. La femme lui obéit. Tandis que les gens se rassemblaient, son épouse alla le voir et dit :
Mor Lame lève-toi, ils sont prêts à t'enterrer.
Où est l'os ? murmura le faux mort. Dans la marmite au feu, répondit sa femme. S'est‑il ramolli ? Oui, il s'est ramolli.
Et Moussa ? Il est là. ?
La population fut présente et on invita ceux qui sont chargés de laver les morts de commencer leur travail.
La femme revint vers son mari et reprit « Lève-toi Mor » « Où est l'os? » Demanda t-il. « Dans la marmite au feu ». « Et Moussa ? Il est toujours là. »
- Ils veulent te laver. Oui qu'ils me lavent
On le lava et il resta sur la natte dans le linceul blanc. Ensuite, et on le mit dans le cercueil et l'enterra enfin. Son épouse s'approcha du chef fossoyeur et lui demanda de lui permettre de dire une dernière prière à son mari afin que celui‑ci soit accepté dans le royaume de Dieu. Le chef fossoyeur accepta sa proposition. Elle alla voir son homme en sanglot et dit : « Mor lève-toi ! Ils veulent te mettre dans le cercueil et t'enterrer ; lève‑toi » « où est l'os ? » « Dans la marmite au feu » « S'est-il ramolli ? » « Oui il est ramolli » « Et Moussa ? Il est toujours là ? Qu'on me mette dans le linceul blanc, qu'on me mette dans le cercueil et qu'on m'enterre enfin. »
La femme se retourna en larme. Le chef fossoyeur le mit dans le linceul blanc puis dans le cercueil. On entonna des chansons funéraires et le cortège démarra pour le cimetière. On y est déjà arrivé. Le cercueil est a dépassé la longueur de la fosse et le chef fossoyeur ordonna qu'on jetât les premières poignées de sable sur celui‑ci. A peine la population commença‑t‑elle à obéir à cet ordre que la femme demanda sa même permission de prière au chef‑ fossoyeur qui accepta. Elle alla dans le trou, se baissa et dit à son mari les yeux pleins de lames.
« Mor lève‑toi » « Où est l'os ? » s'enquit‑il à travers le linceul et le cercueil. « Dans la marmite au feu. » « S'est-il ramolli ? » « Oui il s'est amolli ». « Et Moussa ? Il est toujours là ? ».
Ils jettent déjà les premières poignées de sable sur le cercueil. « Ils vont t'enterrer vivant » « Qu'ils m'enterrent »
La femme sortit et l'on combla la fosse de sable. Tous retournèrent à la maison. Le chef de la famille de Mor Larme appela Moussa et lui dit: « Tu as été pendant longtemps le confrère de Mor Larme ; son « plus que frère ». Raison pour laquelle à la fin du veuvage de sa femme, tu la prendras pour épouse. Elle ne commencera à vivre dans d'autres mains que dans les tiennes. Je te la remets. Garde-la bien ».
Ainsi donc, Moussa hérita la femme de son ami mort pour avarie, maintenant, il dit à la femme: « Où est l'os ? » « Dans la marmite, au feu » « S'est‑il ramolli ? » « Oui il s'est ramolli. » « Amène‑le pour que nous le mangions ».
La femme l'amena à Moussa et ensemble ils le mangèrent.
Mor Lame s'est laissé enterrer vivant pour n'avoir pas voulu partager un simple os avec son confrère Moussa. A sa mort, Moussa a pris sa femme et ensemble ceux-ci ont mangé le menu.
De toute évidence l'avarice perd tout en voulant tout gagner. Mor Lame en voulant gagner l'os, perdu et l'os, et sa femme et la vie. Gardons‑nous donc de l'avarice et nous vivons heureux.
Les contes d’Amadou KOUMBA de Birago DIOP
«Transmettre à nos enfants notre bon héritage culturel qui leur permet de se connaître»
Les Contes d'Amadou Koumba, Paris, Fasquelle, coll. « Écrivains d'Outre-Mer », 1947
Les Contes d’Amadou Koumba est une collection de contes venant de la tradition orale sénégalaise. Ce livre est un des premières tentatives de mettre en écriture les contes oraux des ‘griots’ Wolofs et sert à informer les lecteurs Européennes de la culture Africaine. Dans ce livre, nos contes favoris étaient « Maman-Caïman », un conte d’apprentissage, et « Fari L’Annesse », un conte de métamorphose.
Voyage dans le temps, dans les thèmes, dans les mots. Thèmes traditionnels et originaux, bestiaire cruel et tendre aux multiples aventures, univers des hommes, immuable. Amadou koumba, griot, conteur, chanteur, diali au Soudan, guéwèl au Sénégal, celui qui transmet la parole, le message au fil des générations. C'est lui qui relate à Birago Diop, des histoires, des contes et des légendes, rythmés par le tam-tam ou la calebasse. Une profusion de sentiments saisissent le lecteur : la frayeur, la gaieté, l'émotion se relaient. Golo, le singe, est à l'origine de la réputation de Koumba qui, avec son ancien mari, ira à Maka-Kouli pour entendre la sentence du marabout. Sagesse, humour et réalisme : "On ne connaît l'utilité des fesses que quand vient l'heure de s'asseoir!". |
"Quand la mémoire va ramasser du bois mort, elle rapporte le fagot qui lui plaît"…jeux des souvenirs, poésie des saisons, nostalgie des retours au pays, interventions de génies malicieux…
Les bêtes donnent parfois des leçons aux humains mais souvent la cruauté des hommes prend le pas sur l'innocence de l'animal.
Les défauts ne sont pas l'apanage de l'homme, et les animaux - acteurs - personnages - apparaissent avec leurs travers, ruse, paresse, débauche; tel Golo le singe, encore lui, mauvais sujet, querelleur, malicieux, menteur.
Saga animalière et humaine qui puise ses sources dans la vie elle-même, alchime universelle entre les êtres et les éléments.
Trois contes, intitulés "Les mauvaises compagnies", rassemblent les acteurs animaux, le crabe, le rat, le caméléon, le coq, le crapaud, qui entretiennent des relations où la ruse et les coups bas l'emportent sur l'amitié.
Les traditions, les rites populaires et ancestraux sont toujours présents au cœur des récits et nouent ainsi des liens entre le passé et le présent. Par le biais des histoires, nous pénétrons donc dans l'univers tribal rythmé par les coutumes et les cérémonies. Le thème du conte "Petit mari" montre toute l'ampleur tragique d'une histoire d'amour émouvante et désespérée.
Puis, ce sont à nouveau des animaux conduits par M'Bile, la biche, qui se métamorphosent en jeunes femmes pour mettre en péril un chasseur imprudent.
Au fil des récits, Amadou Koumba, conteur, magicien, poète, nous emmène dans un monde proche et lointain à la fois, celui de l'histoire des hommes et des bêtes, toujours recommencée…
A. Defaux
Birago Diop
Le nouveau choc des générations par Marie-France CASTAREDE, Samuel DOCK/ ed Plon
Écrit par Pape CISSOKO septembre 2015
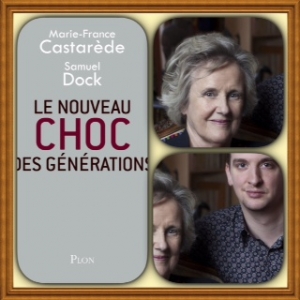
À l'heure ou la fracture séparant les âges n'a jamais semblé aussi profonde, les auteurs invitent le lecteur à un voyage unique entre deux voix, deux regards, deux époques, sur des thèmes fondamentaux tels que le corps, le couple, la famille, le temps, l'image...
En 1971, l'anthropologue Margaret Mead publiait Le Fossé des générations. Elle y insistait sur la nécessité de rétablir le dialogue entre les générations passées et présentes.
Que reste-t-il, plus de quarante ans après, de son message ?
C'est cette question essentielle qui a servi de point de départ à l'échange entre Marie-France Castarède et Samuel Dock. Les auteurs, appartenant à deux générations que tout sépare, croisent leurs regards sur leur époque, leur savoir théorique mais également leur vécu. Ils analysent les mécanismes sociaux, culturels et psychologiques d'un conflit intergénérationnel inédit et témoignent d'un bouleversement de l'intime annonçant « le changement profond, peut-être bien la déstabilisation d'une civilisation entière ».
ed plon
Qui sont-ils ?
Deux psychologues que 40 ans séparent. Marie-France Castarède est septuagénaire, elle a enseigné la psychopathologie et la psychanalyse à l'Université de Franche-Comté. Samuel Dock est trentenaire et il fut l'élève de Marie-France Castarède. Aujourd'hui, il est psychologue clinicien. L'un a connu Les Trente Glorieuses, l'autre représente la génération Y. Tous deux portent un intérêt sincère pour le livre Le fossé des générations publié en 1969 par l'anthropologue américaine Margaret Mead qui évoquait déjà la fracture entre les générations dans un contexte où les progrès technologiques étaient croissants. Lors de retrouvailles, Marie-France Castarède prête ce fameux bouquin à Samuel Dock qui le dévore d'une traite. Dans la foulée, il imagine une réactualisation du propos du livre en imaginant un plan détaillé qu'il suggère à Marie-France Castarède. C'est ainsi que Le nouveau choc des générations est né et qu'ils deviennent coauteurs.
Ça parle de quoi ?
Du choc des générations. C'est indéniable, il existe. Pour cela, les deux coauteurs font le pari de rétablir le dialogue entre génération en montrant l'exemple, en s'illustrant dans une conversation commune dans laquelle ils vont parler au lecteur de leurs deux mondes que tout oppose. Pour commencer, ils évoquent les perceptions que chacun a du corps, le rapport à l'image avec l'émergence des réseaux sociaux et ses conséquences. Ensemble, en dialoguant, ils constatent que nous sommes passés d'une société patriarcale vers une société narcissique. La faim de l'image est-elle une fin en soi ? Cette société de consommation nous déshumanise-t-elle ? Marie-France Castarède et Samuel Dock s'interrogent aussi sur la façon dont chaque individu évolue dans sa temporalité, sur le couple et sur les mutations de la famille.
Pourquoi on aime ?
Parce que ce livre démontre qu'il est encore possible de s'entendre. Malgré des divergences et des expériences différentes, l'avenir se prépare dans l'échange. Et c'est ce que nous prouvent avec exemplarité les deux coauteurs du Nouveau choc des générations en abordant des questions cruciales par le biais d'une conversation raisonnée et bienveillante. Ce n'est pas parce que certains ponts sont coupés que les passerelles de secours sont endommagées. Bien au contraire, en analysant les failles de notre société avec pédagogie, Marie-France Castarède et Samuel Dock nous impulsent de l'espoir. Malgré l'écart de génération, les deux coauteurs pensent que dans sa mutation, notre société doit absolument être à dimension humaine.
http://www.metronews.fr/
Marie-France CASTAREDE
Marie-France Castarède, née en 1940, est professeur des universités en psychopathologie et psychanalyste. Parmi ses nombreuses publications, son Introduction à la psychologie clinique (2003) est aujourd'hui une des références universitaires les plus lues.
Samuel DOCK
Samuel Dock, psychologue clinicien né en 1985, appartient à la génération Y. Son premier roman, L'Apocalypse de Jonathan (2012), a rencontré l'engouement du public et de la critique. Depuis avril 2012, il traite des grands sujets d'actualité dans une tribune libre au Huffington Post.
La réussite scolaire est une affaire collective : bonne rentrée à tous et soyons attentifs ensemble pour mieux accompagner nos enfants
Aoû 25, 2015 Pape CISSOKO
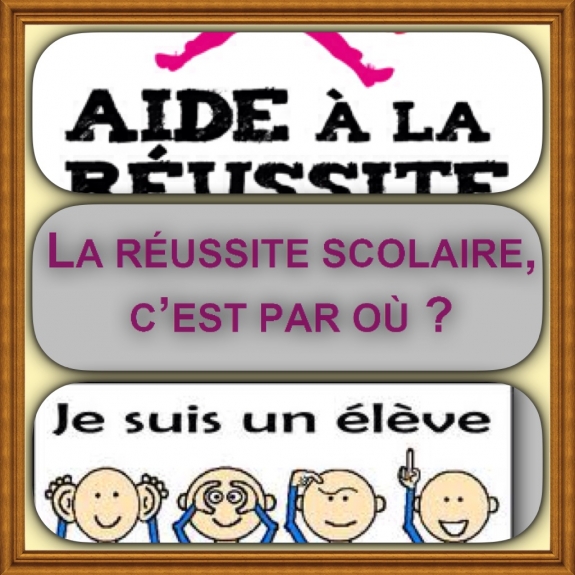
On discute beaucoup de l'école, de la formation de base dans le système éducatif français, mais le problème dépasse ce pays et frappe d'autres pays.
Pour peu qu'on soit né en France de l'autre côté du périphérique on est programmé pour échouer. Pourquoi donc ?
Que fait l'éducation nationale pour pallier ce phénomène ?
Les spécialistes pointent différents arguments, pour redorer le niveau des élèves où qu'ils soient d'où qu'ils viennent, bref il faut promouvoir l'égalité des chances et des moyens, certes une utopie mais si l'intention est là c'est déjà un grand pas.
On évalue mal les élèves, on laisse tous les élèves avancer dans le cursus sans rien assimiler. On voit de plus en plus d'étudiants avec un niveau très bas et PISA le démontre chaque année.
C'est très tôt au niveau des cycles qu'il faut évaluer pour rapidement repérer sans discriminer les enfants, en vue de les prendre individuellement ou en petits groupes pour améliorer le niveau, corriger les lacunes etc. Certains établissements ont adoptés ce dispositifs qui il est vrai exige des moyens humains mais si on comprend que l'avenir d'un pays est fonction du niveau d'étude ou de formation de ses enfants, rien ne sera trop cher.
Ceux qui sont issus de familles aisées, à l'intérieur du périphérique sont conditionnés pour réussir, ils sont dans de bons établissements, ils ont des professeurs particuliers, ils pratiquent une double langue donc ils sont dans de petits groupes et tout ceci permet de réussir, d'intégrer les classes, puis les grandes écoles de commerce ou autres et de prendre en main les grandes institutions du pays comme leurs parents. Il est clair que nous serons dans le monde d'écrit par Bourdieu et Passeron et voici ce qu'ils en disent dans « les Héritiers « Si l'école aime à proclamer sa fonction d'instrument démocratique de la mobilité sociale, elle a aussi pour fonction de légitimer – et donc, dans une certaine mesure, de perpétuer – les inégalités de chances devant la culture en transmuant par les critères de jugement qu'elle emploie, les privilèges socialement conditionnés en mérites ou en " dons " personnels.
À partir des statistiques qui mesurent l'inégalité des chances d'accès à l'enseignement supérieur selon l'origine sociale et le sexe et en s'appuyant sur l'étude empirique des attitudes des étudiants et de professeurs ainsi que sur l'analyse des règles – souvent non écrites – du jeu universitaire, on peut mettre en évidence, par-delà l'influence des inégalités économiques, le rôle de l'héritage culturel, capital subtil fait de savoirs, de savoir-faire et de savoir-dire, que les enfants des classes favorisées doivent à leur milieu familial et qui constitue un patrimoine d'autant plus rentable que professeurs et étudiants répugnent à le percevoir comme un produit social ».
Les enfants issus de familles instruites reproduisent ou suivent les traces des parents et tout le reste est laissé à la périphérie ou est orienté vers des formations courtes ou « peu gratifiantes».
C'est pourquoi je demande aux parents de demander conseils, d'assister aux réunions dans les écoles, de prendre leurs places dans l'éducation de leurs enfants, s'il le faut se sacrifier pour prendre un professeur particulier, ou voir avec les associations de bénévoles qui donnent du soutien scolaire. Il ne faut pas que les professeurs décident seuls de l'orientation de votre enfant vous sinon ils risquent de les envoyer dans la coiffure, la maçonnerie, la cuisine, la plomberie, etc, je n'ai rien contre quand c'est un choix de l'enfant et des parents. Il n'y aucun enfant programmé pour échouer, c'est le système éducatif et de prise en charge qu'il faut revoir pour accompagner chaque enfant avec ses compétences et lacunes pour le tirer vers le haut.
L'école doit être le creuset de la démocratie et l'expression d'une république juste, solidaire et égalitaire, on ne peut laisser au bord de la route ceux qui ont un rythme lent ou une indisposition conjoncturelle à la réussite.
Des initiatives sont à prendre ici et là, quand les professeurs travaillent ensemble, échangent pour faire le point sur chaque élève plutôt que de penser l'ensemble, nos enfants réussirons et personne ne sera laissé à la périphérie. Les professeurs avec les parents et les élèves mont des projets, l'enfant se sent écouté et il se donne les moyens pour réussir, il faut donner confiance, confier aux enfants des responsabilités sous la vigilance bienveillante des professeurs et des parents. Un enfant a toujours besoin des adultes responsables pour réussir. Les pays du Nord ont des méthodes que nous devons explorer pour que le système éducatif français et africain soit bon.
Je donnerai le mot de la fin à Alain Bentolila
Professeur de linguistique à l'université de Paris Descartes dans « Comment sommes-nous devenus si cons ? Un ouvrage qui est l'expression de sa colère contre la société décadente :
« Le délitement de notre intelligence collective
De mensonges en manipulations, de complaisances en lâchetés, notre intelligence collective se délite jour après jour. Et pendant ce temps-là les zélateurs d'une modernité triomphante célèbrent stupidement l'avènement d'un "monde nouveau" assujetti à la proximité et à l'immédiat, résigné à l'imprécision, soumis au prévisible, abandonné au consensus mou, séduit par le repli communautaire et dominé par la peur de l'autre. Mais ne nous trompons pas d'ennemi! Ce n'est certainement pas la diversité culturelle que nous devons combattre, c'est le danger d'une véritable "consomption culturelle" que nous devons affronter ; celle qui verra nos mémoires vides errer sans but dans un désert aride. Nous sommes devenus cons parce que nous avons renoncé à cultiver notre intelligence commune comme on cultive un champ pour nourrir les siens. Incapables de défendre les valeurs culturelles, sociales et morales qui font notre cohérence et nous leur avons préféré les apparences identitaires, filles de l'entre soi. Le Professeur crie encore et dit « Nous sommes devenus cons parce que nous avons renoncé à cultiver notre intelligence commune comme on cultive un champ pour nourrir les siens. Oubliés le questionnement ferme, le raisonnement rigoureux, la réfutation exigeante ; toutes activités tenues pour ringardes et terriblement ennuyeuses. Car c'est bien de cela qu'il s'agit : nous sommes devenus - parents, enseignants, politiques - incapables de mener les batailles nécessaires : celles dont on accepte de ne pas voir l'issue, en étant heureux que d'autres - nos élèves, nos enfants, nos rivaux d'aujourd'hui - les poursuivent parce qu'elles sont essentielles. Du « à quoi bon ! » au « après moi le déluge ! » il n'y a qu'un pas que nous franchissons chaque jour allégrement en nous vautrant dans la prévisibilité d'un audiovisuel débile, en nous abandonnant à l'aléatoire dangereux du web, en acceptant que notre école devienne une machine de reproduction sociale, en tolérant que nos politiques insultent quotidiennement notre intelligence, en laissant enfin abîmer le sacré jusqu'à en faire un masque hideux. Et nous livrons ainsi nos propres enfants à l'inculture et à la crédulité.
A ceux qui confient trop tôt leurs tout-petits à des structures institutionnelles sans se poser la question de l'attachement ; à ceux qui acceptent que des jeunes soient livrés à un monde dangereux sans qu'on leur ait donné la formation intellectuelle nécessaire pour en dénoncer les mensonges ; à ceux qui, cachés derrière leur écran, ont renoncé à regarder l'Autre dans les yeux ; à ceux que l'inconnu et le différent, exaspèrent et terrorisent ; à tous ceux enfin qui souillent l'idée même du spirituel à force d'hypocrisie et de bêtise, à tous ce livre est dédié ! »
Pour une école égalitaire où chacun sera pris en charge en vue de sa réussite.
Conseils de lecture :
« Comment sommes-nous devenus si cons ? livre d'Alain Bentolila First éditions
Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron Les Héritiers
Les étudiants et la culture 1964 Collection « Le sens commun », 192 pages
Pape B CISSOKO
Le mur de Berlin est tombé d’autres murs fleurissent partout : où est l’humanisme face à tant de morts violentes
Pape CISSOKO
Pape B CISSOKO rejoint www.ichrono.info depuis Août 2012
Il arrive, il est là et bien là à ichrono.info .Il s’agit de Pape Bakary CISSOKO, un Philosophe, un conférencier et un Formateur.
Après avoir commencé ses études à l’UCAD de Dakar, il poursuit ses études de Philosophie à Besançon en France. Ce polymathe est un touche à tout. Diplômé dans l’animation BAFA, BADF, il a appris à connaître les cultures occidentales. Animateur de radio, il a rencontré et reçu plusieurs nationalités pour comprendre l’autre le différent.
Créateur et animateur de Café-Philo, il a participé à la vulgarisation de la philosophie sans la galvauder. (Besançon, Tahiti, Belfort, Paris, etc.). Mr Pape Bakary CISSOKO est membre de plusieurs cercles dans le souci d’apprendre et d’approfondir ses connaissances :
Membre de la Société des Africanistes du Trocadéro puis du Musée du Quai Branly, cette société regroupe les plus grands penseurs de l’Afrique ( Sociologues, philosophes, écrivains, linguistes, anthropologues etc- Philippe Laburthe-TOLRA, Mauss, Diéterlen, Balandier , Geneviève Calame-Griaule etc).
Membre de la Maison de la Négritude et des droits de l’Homme de CHAMPAGNEY le prototype de la Maison des Esclaves du Sénégal en France. Pendant dix ans Pape Bakary CISSOKO a enseigné à l’IUFM ( Institut Universitaire de Formation des Maîtres) les Cultures africaines. Vacataire à l’Université Paris V dans le Diplôme Universitaire DU, porté par le Centre Minkowska : Santé et Cultures
Il ne s’arrête pas là, il est souvent en mission de formation pour le compte du Centre Médico Psycho Social pour Migrants et Réfugiés/ Centre Françoise Minkowska Paris 17. Infatigable personnage, écouté et respecté, il est souvent invité à la Radio Internationale AFRICA No 1 sur les questions sociétales et de géo-politiques.
Il nous est difficile de dresser ici, dans ce sobre cadre de sa présentation ou sa bio bibliographie, tout le parcours de notre nouveau collaborateur et contributeur. De Paris au Luxembourg en passant par la Belgique et le monde Pape Bakary CISSOKO a exercé ses talents de formateurs et conférencier en inter-culturalité et parentalité.
Rigoureux, sagace, pragmatique et lucide il n’utilise que sa raison pour décortiquer et comprendre les éléments . Comme Nietzsche, pape utilise son marteau pour casser le tout, le composé pour traiter les parties en vue de reformer le puzzle qui sera le tout.
Pour rencontrer Pape Bakary CISSOKO, nous vous invitons à le suivre dorénavant sur notre site www.ichrono.info,
Par Ichrono

Excellent ouvrage qui remet l’homme noir en question.
L’homme noir n’aime pas trop l’auto critique, il aime se complaire dans le passé et pense que celui-ci l’empêche d’avancer. Mabanckou l’exhorte à se prendre en main et à vivre dans le Présent.
La colonisation, l’esclavage, l’Afrique idyllique, de la solidarité tout ceci est à interroger. Nous sommes tous africains certes mais tous différents. Le noir de France demande qu’on le traite autrement mais il veut appartenir à ces deux cultures, il est français par provision alors que la mondialisation veut que ces jeunes de la seconde génération s’impliquent et se redéfinissent pleinement comme français, il faut refuser le sentiment d’imposture. Né en France de parents étrangers, ce noir est et doit être français totalement, il doit s’impliquer et prendre sa part tout en contribuant à la création de sa place.
Dans cet ouvrage la situation de l’étudiant noir est bien écrite, galère, débrouille et solidarité
Cet ouvrage est à lire avec un esprit apaisé, il nous permet de comprendre le noir noir sans le galvauder.
Pape Bakary CISSOKO 24/06/2012 Choisy le Roi France
- Le sanglot de l'homme noir
- Alain Mabanckou
- Date de Parution : 04/01/2012
- Collection : Littérature Française
- Prix public TTC : 15,30 €
- Code ISBN / EAN : 9782213635187 / hachette : 3537636
- Format (120 x 185) Nombre de pages : 184
« Je suis noir, et forcément ça se voit. Du coup les Noirs que
je croise à Paris m’appellent « mon frère ». Le sommes
nous vraiment ? Qu’ont en commun un Antillais, un
Sénégalais, et un Noir né dans le Xème arrondissement,
sinon la couleur à laquelle ils se plaignent d’être
constamment réduits ?
J’oublie évidemment la généalogie qu’ils se sont forgée,
celle du malheur et de l’humiliation – traite négrière,
colonisation, conditions de vie des immigrés... Car par-
delà la peau, ce qui les réunit, ce sont leurs sanglots.
Je ne conteste pas les souffrances qu’ont subies et que
subissent encore les Noirs. Je conteste la tendance à
ériger ces souffrances en signes d’identité. Je suis né
au Congo Brazzaville, j’ai étudié en France, j’enseigne
désormais en Californie. Je suis noir, muni d’un passe-
port français et d’une carte verte. Qui suis-je ? J’aurais
bien du mal à le dire. Mais je refuse de me définir par
les larmes et le ressentiment.
A.M.
Alain Mabanckou, prix Renaudot pour Mémoires de
porc-épic (Le Seuil, 2006), est l’auteur chez Fayard de
Lettre à Jimmy (2007).
Décembre 2011
Je viens de recevoir de l'éditeur canadien cet excellent ouvrage sur la Mort musulmane.Cet ouvrage invite au savoir sans phares,
Ce travail est scientifique et sans complaisance, travailleurs sociaux, institutionnels et particuliers devraient se l'approprier.
pape B CISSOKO
La mort musulmane en contexte d'immigration et d'islam minoritaire. Enjeux religieux, culturels, identitaires et espaces de négociations

- Auteur : Khadiyatoulah Fall, Mamadou Ndongo Dimé
- Collection : Intercultures
- Discipline : Culture
- 238 pages
- Novembre 2011
- ISBN : 978-2-7637-9545-4
ISBN-PDF : 9782763795461
Résumé :
Sous la direction de Khadiyatoulah Fall et Mamadou Ndongo Dimé
Cet ouvrage constitue les actes du colloque international et interdisciplinaire tenu à Chicoutimi sur la problématique de la mort musulmane en contexte d’immigration et d’islam minoritaire par la Chaire d’enseignement et de recherche interethniques et interculturels (CERII), en collaboration avec le Célat, les 7 et 8 octobre 2010. L’objectif de ce colloque, le premier à se tenir au Canada sur ce thème, était de faire un état des lieux des questionnements scientifiques, sociaux, religieux, culturels et identitaires que soulève la mort dans les communautés musulmanes en contexte d’immigration ainsi que des tensions, négociations, adaptations et « accommodements » qu’elle suscite en contexte d’islam minoritaire au Québec et ailleurs en Occident.
Les textes de cet ouvrage illustrent l’importance d’un nouveau chantier de recherche dans les études sur la présence de la religion musulmane au Québec ainsi que les défis de l’interculturalité et du vivre-ensemble qu’il porte. En plus d’une participation significative des intervenants sociaux et des représentants des cultes, le colloque a réuni d’éminents chercheurs de différents pays (France, Suisse, Maroc et Québec) et de disciplines scientifiques variées (sociologie, anthropologie, sciences du langage, sciences religieuses, sciences de la communication, sciences politiques, etc.).
Auteurs : Khadiyatoulah Fall (Québec), Mamadou Ndongo Dimé (Québec), Stéphane Lathion (Suisse), Atmane Aggoun (France), Mostafa Brahami (Suisse), Said Maghnaoui (Maroc), Aline Degorce (Burkina Faso), Jean-Jacques Lavoie (Québec), Nicole Bouchard (Québec), Mohamed Zéhiri (Québec) Jean-René Milot (Québec), Frédéric Castel (Québec) et Raymonde Venditti (Québec).
Biographie :
Khadiyatoulah Fall
Professeur à l’Université du Québec à Chicoutimi, Khadiyatoulah Fall est titulaire de la Chaire d’enseignement et de recherche inter ethniques et interculturels (CERII) de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) depuis 1995. Il est également chercheur senior au Centre interuniversitaire et interdisciplinaire d’études sur les lettres, les arts et les traditions (CELAT). Il est docteur en sciences du langage et s’intéresse particulièrement à l’étude des processus de production et d’interprétation des sens, des savoirs, des connaissances et des représentations sociales dans les discours scientifiques, les discours politiques et dans les discours interculturels. M. Fall est l’auteur de plus de 172 articles dans des revues scientifiques internationales évaluées par les pairs et auteur et co-auteur de 19 livres scientifiques.
Mamadou Ndongo Dimé Titulaire d’un doctorat en sociologie de l’Université de Montréal, Mamadou Ndongo Dimé est chercheur postdoctoral à la Chaire d’enseignement et de recherches interethniques et interculturels de l’UQAC et boursier du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Ses recherches actuelles portent sur les enjeux identitaires et culturels reliés à la mort musulmane en contexte d’immigration, notamment dans les communautés musulmanes originaires de l’Afrique de l’Ouest. Ses autres intérêts de recherche sont le développement international, la dynamique des solidarités familiales, la précarité en milieu urbain africain, thèmes sur lesquels il a à son actif de nombreuses publications.
Pape B CISSOKO Décembre 2O11
Universitaire convaincant et convaincu, savant et polymathe, africaniste et professeur . Le PR D SAMB ne veut pas juger , en tant qu'historien de la Philosophie , il expose les faits et essaie de comprendre , il nous donne les outils de compréhension qui nous permettront d'avancer ou de résister avec les arguments de la science contre les /
Pape CISSOKO
A Lire chez L'Harmattan Novembre 2010
LE VOCABULAIRE DES PHILOSOPHES AFRICAINS
Djibril Samb

Paru le : 09/12/2010 – Editeur : L'Harmattan – Collection : Ouverture philosophique – Prix : 30 €
Le Vocabulaire des philosophes africains comporte 100 entrées réparties en cinq catégories de lexiques : 1) un lexique de base de la philosophie avec les sens usuels des concepts (Dieu, éthique, être, logique, etc.) et leurs infléchissements par les philosophes africains ; 2) un lexique de base de la philosophie (être, substance, temps, âme, etc.) avec des connotations particulières en Afrique noire ; 3) un lexique non philosophique dans les langues occidentales (ancêtre, sorcellerie, défunt, etc.), mais investi d'acceptions philosophiques propres à la philosophie africaine ; 4) un lexique spécifique issu des langues africaines (ntu, muntu, ori, nommo, nyama, etc.), qui contribue à donner à la philosophie africaine son cachet propre ; 5) enfin, quelques termes spéciaux (consciencisme, éviternité, négritude) introduits par des penseurs ou philosophes africains.
Il comporte également un glossaire de 167 termes issus des langues africaines, 106 notices biographiques d'auteurs, africains essentiellement, que l'on peut désormais situer, un tableau chronologique 1900-2008 qui permet de souligner les étapes de la philosophie africaine, mises en regard des événements historiques ou culturels significatifs de l'Afrique noire et, enfin, une liste des périodiques philosophiques ou accueillant des travaux philosophiques édités en Afrique subsaharienne.
Cet ouvrage est une " étude purement historique et scientifique de la philosophie africaine ", à laquelle elle constitue en même temps une sorte d'introduction.
Les Mutations de la famille africaine ici et ailleurs
Mutations de la famille africaine - La parentalité au carrefour des modèles éducatifs
Voici un excellent ouvrage que chacun devra avoir pour comprendre notre monde. Le monde évolue et les personnes aussi, celui qui refuse de s'intégrer de façon intelligente se perd / Pape CISSOKO
Les parents africains de la diaspora ne peuvent que s'aligner sur le schéma de ces grandes mutations qu'offre la famille africaine d'aujourd'hui.
En dépit de l'éducation africaine qu'ils ont reçue, de leurs convictions, de la nostalgie qui les animent constamment, ils ne peuvent contourner les Droits dont doivent bénéficier tous les enfants, notamment les enfants français d'origine africaine. Certes, de nombreuses ruptures ont été produites par la modernité et la rencontre des cultures. La continuité du modèle africain traditionnel ne peut être répétée et appliquée systématiquement dans la société d'accueil.
Le conflit de générations qui les oppose à leurs enfants s'explique par le choc de la rencontre des cultures familiales, des styles éducatifs ; les contrastes entre les expériences de génération sont frappants. Les parents nés en Afrique, même s'ils étaient citadins et scolarisés, restent profondément attachés aux valeurs africaines qu'ils ont intériorisées depuis leur plus jeune âge et qu'ils veulent transmettre à leur tour à leur progéniture.
Et les enfants nés et/ou élevés en Europe, notamment ceux qui n'ont jamais été en Afrique, constituent une génération sans expérience de la vie africaine. Cette portée, très significative, induit des comportements qui peuvent créer des tensions familiales et font apparaître un décalage dans les représentations sociales entre les parents africains qui seront vus plus stricts et les non africains qui seront considérés comme plus indulgents.
A lire chez l'Harmattan
La violence faite aux femmes ne cesse d'augmenter dans le monde et aucune couche de la population n'est épargnée. 25/11/2010
Pourquoi tant de haine envers les femmes, pourquoi les femmes sont si décriées alors que c'est la mère celle qui nous donne la Vie.
Pourquoi certains hommes tombent sous le coup de leurs épouses ?
Il n'a en a pas beaucoup comparativement aux femmes victimes?
Au Canada, en France et ailleurs on ne comprend pas, les lois se mettent en place pour protéger les victimes
Il me semble qu'il faut plus miser sur l'éducation du genre humain, expliquer que nous devons d'abord considérer la personne avant de fixer le sexe.
Dans les manuels scolaires, dans la publicité, dans les jouets, l'image de la femme comme être faible, cantonnée aux activités domestiques et de subordination façonnent le regard des gens, il faut corriger cette image, la femme est une Personne et mérite en tant que tel le RESPECT.
En Afrique l'instruction et le changement des mentalités sur
la femme permettront de de sauver la femme de la domination masculine
ou la barbarie de certains hommes. Les mouvements des femmes sont le
rempart et le droit facilite la sécurité et la protection
des femmes et des êtres humains.
La violence est l'arme des faibles , ensemble trouvons les moyens de
nous éduquer, de nous respecter dans la différence
et la haine ne peut nous mener dans l'iunivers du vivre ensemble
VOICI UN POEME DE CAMARA LAYE
Eloge à la Femme où qu'elle soit
A ma mère
Femme noire, femme africaine,
Ô toi ma mère, je pense à toi
Ô Dôman, ô ma mère, toi qui me portas sur le
dos,
Toi qui m'allaitas, toi qui gouvernas mes premiers pas,
Toi qui, la première, m'ouvris les yeux aux prodiges de la terre,
Je pense à toi...
Femme des champs, des rivières, femme du grand fleuve,
Ô toi, ma mère, je pense à toi...
Ô toi Dâman, ô ma mère, toi qui essuyais mes
larmes,
Toi qui me réjouissais le cÏur, toi qui, patiemment,
supportais mes caprices,
Comme j'aimerais encore être près de toi, être enfant
près de toi !
Femme simple, femme de la négation,
ma pensée toujours se tourne vers toi...
Ô Dâman, Dâman de la grande famille des forgerons,
ma pensée toujours se tourne vers toi,
La tienne à chaque pas m'accompagne, ô Dâman, ma
mère,
Comme j'aimerais encore être dans ta chaleur,
être enfant près de toi. ...
Femme noire, femme africaine,
ô toi ma mère, merci pour tout ce que tu fis pour moi,
ton fils,
Si loin, si loin, si près de toi !
Je t'aime,
je t'aimais,
je t'aimerais toujours!
CAMARA Laye ( Guinée Conakry)
HOMME ET FEMMES DEVRONT VIVRE DANS LE RESPECT ET SANS VIOLENCE.
Nouvelles difficultés à réfléchir : Le conflit entre enfants issus de parents immigrés.
Un conflit de génération qui peut tourner au drame.
Rupture de communication et volonté de quitter le domicile,
Danger : la rue
Une éducation austère est-elle viable ?
Comment concilier valeurs traditionnelles et la culture métisse, celle de nos enfants à la double culture ?
Que faire ? Comment rétablir le contact pour un meilleur vivre ensemble ?
L'Oeil sur le cinéma africain en Val de Marne
CRETEIL du 16 AU 30 NOVEMBRE 2010
UN FILM AFRICAIN A QUELQUE FOIS BESOIN D'ETRE ACCOMPAGNE POUR ETRE BIEN COMPRIS PAR LES AUTRES.
C'est pourquoi le Cinema de la LUCARNE à CRETEIL m 'a sollicité pour animer un débat après la projection du film.
FESTIVAL L'ŒIL VERS …L’AFRIQUE NOIRE
L’Afrique, aujourd’hui
La 29e édition du festival L’Œil vers… porte
son regard sur l’Afrique noire. C’est au cinéma La
Lucarne que le public cristolien pourra découvrir l’intégralité
de la programmation, du 16 au 30 novembre.
Déjà en 1999, Les Journées cinématographiques
du Val-de-Marne contre le racisme, pour l’amitié entre
les peuples, avaient entraîné leurs spectateurs vers l’Afrique
noire, avec le plus grand succès connu de cette manifestation.
Onze ans plus tard, à l’heure où l’Afrique
tente de se construire un avenir, elle est à nouveau à
l’affiche du festival L’Œil vers... qui investit les
écrans de onze salles du département. À Créteil,
l’intégralité de la programmation sera présentée
à La Lucarne du 16 au 30 novembre.
Waliden, enfat d'autrui d'Awa Traoré
À travers des genres très divers, les réalisateurs africains témoignent d’une grande conscience des situations et des problèmes de leurs sociétés. Ils nous offrent des personnages forts, charismatiques ou dérangeants, et de superbes portraits. Ainsi, l’Afrique universelle compose le décor de Moolaadé du Sénégalais Ousmane Sembène. Ses personnages sont les héros d’un drame qui dénonce l’excision, l’archaïsme. Le Camerounais Jean-Marie Téno filme Le Mariage d’Alex en s’interrogeant sur la polygamie. Pour Si Gueriki, la Reine-Mère, la caméra d’Idrissou Mora Kpai approche le cercle des épouses, explorant leurs relations. Celle de la Malienne Awa Traoré aborde l’adoption dans Waliden, enfant d’autrui, tandis qu’Osvalde Lewat dans Une affaire de nègres porte le regard sur les dérives de la communauté camerounaise.
Une vision en mouvement
Mais le cinéma s’emploie aussi à réfléchir
sur l’histoire de l’Afrique et des conflits qui l’agitent.
Ntshavheni Wa Luruli cadre la violence des townships de l’Afrique
du Sud. Dans Un héros, Zézé Gamboa aborde les conflits
en Angola. Les échos du génocide rwandais résonnent
dans Munyurangabo de Lee Isaac Chung. Haïlé Gérima
revisite l’évolution de l’Éthiopie dans Téza.
Mahamat-Saleh Haroun, dans Un homme qui crie, traite de la douleur d’un
père spolié après les destructions de la guerre
civile au Tchad. Mais les films se teintent aussi d’originalité,
de fantaisie et d’éclats de rire quand il s’agit
de conjurer les mauvais sorts.
Moolaadé d'Ousmane Sembène
Madame Brouette, comédie touchante de Moussa Sena Absa, exalte
les couleurs du Sénégal. Dans Paris selon Moussa de Cheik
Doukouré, la quête burlesque d’un motopompe est l’occasion
de côtoyer les sans-papiers africains.
Mélange des genres et d’émotions, à travers quinze films, la programmation du festival donne une vision en mouvement de l’Afrique noire d’aujourd’hui. “Des films qui, pour cette édition, nous arrivent de pays plus nombreux et de régions plus diverses du continent, témoignent d’une soif de renouvellement des sociétés et de la quête des individus qui ouvrent leurs existences à l’inconnu”, concluent les organisateurs de ces Journées cinématographiques.
Cinéma La Lucarne
MJC du Mont-Mesly, 100, rue Juliette-Savar
Tél. : 01 45 13 17 00 et 01 43 77 58 60 [répondeur]
Les soirées-débats
• Vendredi 19 novembre à 21h
Projection de Waliden, enfant d’autrui d’Awa Traoré,
suivie d’une rencontre avec le producteur Laurent Bocahut, en
présence d’Oumy Diasse, présidente de l’association
À Cœur Ouvert.
• Dimanche 21 novembre à 14h30
À l’initiative de l’association Sonikara, projection
de Correspondances, autour du travail de Laurence Petit-Jouvet, suivie
d’une rencontre avec Fatou M’Baye, Pauline Anamba-Onana
et Oumy Diasse sur la situation des femmes africaines dans la société
française (collation africaine).
• Dimanche 21 novembre à 17h
Projection de Paris selon Moussa de Cheik Doukouré suivie d’une
rencontre avec le réalisateur, en présence de l’association
Sonikara.
• Mardi 23 novembre à 21h
Projection de Munyurangabo de Lee Isaac Chung, suivie d’un débat
avec Pape Bakary Cissoko, philosophe et formateur dans le domaine de
l’interculturalité.
• Vendredi 26 novembre à 20h30
À l’initiative de la Ligue des droits de l’homme
de Créteil, projection de Nothing But The Truth, une vérité
sud-africaine de John Kani, suivie d’un débat sur l’Afrique
du Sud d’après l’apartheid.
• Mardi 30 novembre à 20h45
Projections du Mariage d’Alex de Jean-Marie Téno et de
Si Gueriki d’Idrissou Mora Kpai, suivies d’une rencontre
avec Jean-Marie Téno.
Les animations
• Samedi 20 novembre à 17h
Vernissage de l’exposition d’arts plastiques autour des
“Imaginaires de l’Afrique”, au centre Madeleine-Rebérioux
(01 41 94 18 15).
• Samedi 20 novembre de 14h30 à 17h [centreMadeleine-Rébérioux]
et dimanche 21 novembre de 14h30 à 17h [MJC du Mont-Mesly]
Stages gratuits de percussions (djembé, balafons, doum-doum…)
ou de danse, animés par l’association Ngamb’art (Burkina
Faso), ouverts aux adultes et aux jeunes à partir de 14 ans.
Informations au 01 45 13 17 00 ou au 01 41 94 18 15.
• Samedi 27 novembre
Animations pour tous à partir de 8 ans.
14h30 : projection de Un transport en commun de Dyana Gaye au cinéma
La Lucarne.
16h : goûter en musique et danse au centre Rebérioux.
17h : Grandes jambes, fable théâtrale par la Compagnie
des Ventres au centre Rebérioux.
Tarif pour l’après-midi : 4,50 € (adultes) et 3,50
€ (enfants).
Entrée libre pour Grandes jambes.
Informations et réservations au 01 41 94 18 15.
• Dimanche 28 novembre à 17h
Concert de percussions (rythmes soussou et malinké) par Thierry
Duprat et ses élèves accompagnant la danseuse Aya Aliman,
suivi de la projection de Un transport en commun.
Pape Cissoko : s'ouvrir à l'autre :
" Donner et recevoir, c'est ma philosophie ". Bakary Pape
Cissoko s'est installé voici un peu moins d'un an dans le Val-de-Marne.
Et déjà il met en route des projets d'alphabétisations,
d'animation, de café-philo. Mais aussi il prépare sa thèse
de philosophie sur les arts premiers, donne des cours de culture africaine
à l'Institut de formation des maîtres à Besançon
et travaille comme animateurs dans les centres de loisirs du Conseil
général.
On l'aura vite compris, Pape est un hyper-actif, résolu
à coprendre le monde par la rencontre et à le changer.
" Ma vie n'a pas de sens sans action ", dit-il.
Ce jeune Sénégalais explique que l'on a trop souvent tendance
en France à minimiser la portée de la culture africaine.
" Je viens ici vous éduquer, affirme-t-il en plaisantant.
En fait, je crois à l'échange. Il faut s'ouvrir à
l'autre pour se comprendre s'enrichir. "
(Mai 2001 - no 170 - Connaissance du Val-de-Marne)
- Du 10 au 15 Février 2003 :
Cours complémentaire à l'IUFM de Franche-Comté
sur le thème :
"A la découverte de l'Afrique Noire".
Ce cours est destiné au futurs enseignants (instituteurs,professeurs
pour leur donné des clés pour mieux comprendre les cultures
africaines.
Plusieurs aspects sont abordés :
Géo-politique, culture, famille, éducation, arts, cérémonies
familiales, religions, questions de développements et d'économie,
les conflits etc...
Cette semaine est l'occasion de vivre autrement l'interculturalité. L'enseignant est celui qui doit avoir l'esprit extrènement ouvert pour mieux faire son métier etc...
- Lundi 10 Mars 2003, dans le cadre des soirées
à thèmes du centre Minkowska à Paris ( Ethnopsychatrie).
Projection suivie d'un débat sur les représentations culturelles
de la maladie mentale en Afrique avec le Docteur Maurice DORES, réalisateur
du film BOROM XAM-XAM avec la participation et les contributions de
Pape Bakary CISSOKO, philosophe et conférencier. Le 5 et 12 Février
2003, sur Africa N°1 Radio Internationale, Pape Bakary CISSOKO
sera l'invité de Gilles AHADZI sur les thèmes de :
- Union Africaine,l'Islam en France.Pape Bakary CISSOKO est déjà intervenu au JDA de Gilles AHADZI, Africa N°1 à Paris : Nelson Mandela, un modèle politique, la preprésentation des noirs sur l'échiquier politique français, le naufrage du bâteau "le joola" avec la participation de l'ambassadeur du Sénégal à Paris, sur "la mentalité primitive"-ouvrage du Professeur Bebbè-Njoh de Cameroun.
Le 5 et 12 Février 2003, sur Africa N°1
Radio Internationale, Pape Bakary CISSOKO sera l'invité de Gilles
AHADZI sur les thèmes de :
- Union Africaine,l'Islam en France.Pape Bakary CISSOKO est déjà intervenu au JDA de Gilles AHADZI, Africa N°1 à Paris : Nelson Mandela, un modèle politique, la preprésentation des noirs sur l'échiquier politique français, le naufrage du bâteau "le joola" avec la participation de l'ambassadeur du Sénégal à Paris, sur "la mentalité primitive"-ouvrage du Professeur Bebbè-Njoh de Cameroun.
- 18 Mars 2003 à l'Espace RMI de Champigny/sur/Marne
au Café Philo&Co
- Pape Cissoko s'ouvrir à l'autre
Mai 2001 - n°170 - Connaissance du Val-de-Marne
